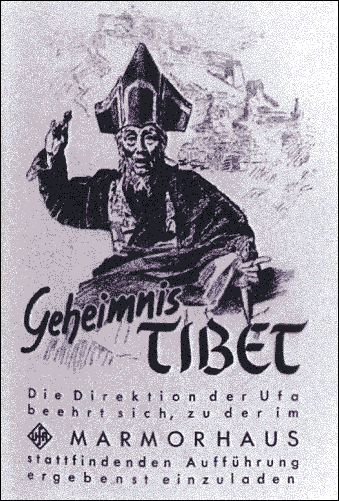|
Victor et Victoria Trimondi
La
connexion Nazis-Tibet
Le Film SS « Le Secret du Tibet »
Le
scientifique Ernst Schäfer, fils d’un influent industriel de Hambourg,
avait déjà participé dans les années trente du siècle précédent à deux
expéditions au Tibet sous la direction américaine de Brook-Dolan. En 1936, il
retint l’attention de Heinrich Himmler qui le nomma
immédiatement « SS-Untersturmführer [sous-lieutenant] dans son Etat-major
personnel. En 1938, l’« Expédition SS Schäfer » fut créée. Dans
l’Ahnenerbe SS, où étaient rassemblés les
intellectuels et les universitaires de l’Ordre Noir, on discutait de
l’existence d’une religion guerrière raciste indo-aryenne ensevelie, à
partir de laquelle, entre autres, des « enseignements de
sagesse » orientaux, comme par exemple le bouddhisme, devaient s’être
développés. Retrouver et reconstruire cette « religion
d’origine » était une demande prioritaire de
Himmler et de son équipe de chercheurs, à laquelle appartenaient aussi des
orientalistes éminents. Ainsi, l’expédition SS au Tibet eut des objectifs
non seulement scientifiques et militaro-politiques, mais aussi religieux et
occultes. Ses chercheurs nazis allèrent dans l’Himalaya avec les missions
suivantes :
1.
Pour prouver que là, dans
les « temps d’origine », une race blanche aryenne avait régné.
Dans cette intention, des recherches archéologiques et des dénommés
« examens de science raciale » furent pratiquées sur des
habitants du pays.
2.
Pour rechercher dans les
monastères tibétains les écrits, dans lesquels le savoir de cette religion
indo-aryenne d’origine était contenu.
3.
Pour conduire des
recherches météorologiques, zoologiques et géologiques.
4.
Pour recueillir des
informations militaro-stratégiques, en particulier sur l’influence de
l’Angleterre dans cette région.
En août
1939, l’« Expédition SS Schäfer » revint en Allemagne et fut
reçue en grande pompe par Himmler à l’aéroport de Munich. Pour ses
résultats extraordinaires, l’explorateur du Tibet reçut la bague SS à tête
de mort et le poignard SS d’honneur. Au printemps 1942, alors que l’armée
allemande avait déjà profondément pénétré à l’Est, le Reichsführer SS ordonna de développer la
« Recherche au Tibet et en Asie ». Celle-ci devenait maintenant
une « recherche pour des buts d’importance de guerre » et tombait
dans la catégorie de « mission scientifique de guerre ».
Durant ces
années, Schäfer développa avec un succès remarquable le Sven Hedin Institut für Innerasienforschung [Institut Sven Hedin pour la recherche en Asie centrale] comme
subdivision de l’Ahnenerbe SS. La véritable
inauguration de l’Institut eut lieu le samedi le 16 janvier 1943 à
l’Université Ludwig Maximilian de Munich. Dans la matinée le titre de
docteur honoris causa fut décerné à l’explorateur suédois de l’Asie Sven Hedin par le recteur de la faculté des sciences
naturelles, Walther Wüst. L’après-midi on projeta
pour la première fois le film de Schäfer Geheimnis
Tibet [Le secret du Tibet] au Palais de l’UFA, au 8 Sonnenstrasse.
Sven Hedin fut complètement enthousiasmé.
« Grandiose, merveilleux, ce
que nous avons vu ici ! » – s’écria-t-il et il serra à nouveau la
main au jeune SS-Untersturmführer Ernst Schäfer :
« Vous êtes l’homme qui devait continuer mes recherches et qui doit
les continuer ! » – lui dit-il. Schäfer fit de l’Institut Sven Hedin le plus grand département de l’Ahnenerbe SS.
Les succès à
l’Est de l’armée allemande et de l’axe Berlin-Tokyo conduisirent à un
intérêt général pour l’Asie. Ainsi, les médias allemands étaient remplis de
reportages sur le Japon, la Chine, l’Inde, la Mongolie et le Tibet, et le
film Le secret du Tibet convenait parfaitement aux buts de la
propagande. Les objectifs suivants étaient ainsi poursuivis :
1.
Un réchauffement de
l’enthousiasme guerrier général.
2.
La glorification des
guerriers d’élite allemands dans l’espace asiatique
3.
Un autoportrait de la
SS comme un institut de recherche, qui s’occupait de relier la science
et l’aventure.
4.
La présentation des
Tibétains comme des alliés possibles contre l’Angleterre, en particulier
contre l’Inde en tant que colonie anglaise.
5.
Une documentation de la recherche
raciale indo-aryenne, qui devait prouver l’existence d’une culture blanche
avancée, ensevelie dans l’Himalaya.
6.
Un intérêt pour les
rituels magiques du lamaïsme.
La version
du film Le secret du Tibet, qui était à notre disposition, commence
par les aspects guerriers et agressifs de la culture tibétaine. Ceux-ci
sont aujourd’hui à peine perçus par le grand public, car l’« ancien
Tibet » est faussement représenté en Occident comme un Etat monastique
aimant la paix, dans lequel la majorité de la population s’adonne à des
pratiques spirituelles. Dès le début du film le spectateur est plongé dans
la « danse de guerre » du dieu protecteur tibétain sanguinaire Mahakala, le terrible Seigneur de la mort et de la
terreur, dans une ambiance guerrière appropriée et excitante. Dans le
scénario on peut lire la phrase suivante : « Les meilleurs des nobles
guerriers rendent hommage au Mahakala. Ils
montrent la force, la dureté et la discipline les plus élevées à leur dieu
de la guerre ».
Dans la
séquence « Taschilhuenpo et Schigatse », dans laquelle Schäfer présente
l’armée tibétaine, nous avons aussi un aperçu du militarisme de l’Etat du
Dalaï-lama : « Ainsi, le drapeau de guerre devient le symbole du
pouvoir central. » – est-il dit de la décision du XIIIe Dalaï-lama de
créer une armée permanente. Tout aussi martiale est la séquence sur
« la célébration du Jour de l’An » : « C’est l’ancien
Tibet héroïque » –, proclame avec enthousiasme un orateur – « au
milieu de la fête de l’Eglise il s’est retrouvé, viril et dur, loin de tout
amollissement monastique ». Tout se termine par une parade
militaire, qui doit rappeler aux visiteurs les armées de Gengis Khan :
« Armes aiguisées ! – annonce le premier. – Bonnes selles ! – annonce
le deuxième. – Chevaux rapides ! – le troisième. – Guerriers courageux ! –
Alors ils repartent vers l’endroit d’où ils sont venus – des steppes et du
désert ».
Dans le
dénommé « camp des morts » du film sont montrées des images
morbides du dépècement et de la consommation des cadavres par des vautours,
présentés comme des « cercueils volants » dans le scénario. Les
SS étaient particulièrement intéressés par de telles scènes macabres de la
culture tibétaine, comme nous l’avons montré dans notre analyse
« Hitler-Bouddha-Krishna ». De même, ils étaient fascinés par le
côté magique du lamaïsme. Très impressionnantes sont les séquences du
« Netschung-Lama », l’oracle d’Etat
tibétain, un médium, qui transmet les conseils d’un dieu guerrier mongol du
nom de Pehar et qui contribue encore aujourd’hui
de façon décisive aux décisions
politiques du XIVe Dalaï-lama. « Un démon vivant rempli d’un pouvoir
énorme », écrit Schäfer à propos de cette scène – « En lui
s’incarne l’ancienne divinité du Tibet qui existait avant les lamas. Il
porte le bonnet géant des anciens prêtres magiciens ». L’image de ce
lama magicien de la secte des bonnets rouges décorait aussi la carte
d’invitation pour la première du film Le secret du Tibet.
L’orientation raciste du film de propagande est montrée en détail par les
mesures et les examens crâniens de Beger.
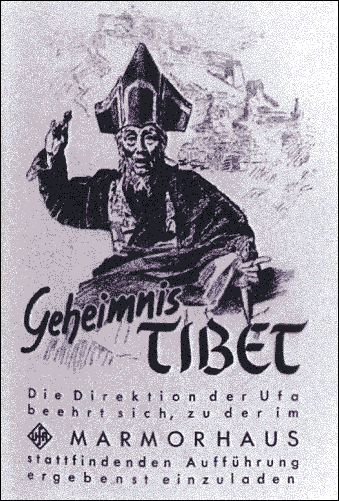
La carte d’invitation à la première du film Le Secret du
Tibet portait
une photographie du célèbre Maître Phurba,
Ling-tsang Gyalpo, de
la
tradition tibétaine Nyingma. Il
était considéré comme une incarnation
du demi-dieu guerrier Gesar de
Ling.

Bien qu’il
présente un autre pays et une autre culture, le film Le secret du Tibet
est imprégné du même esprit qui était alors l’ambiance de l’Allemagne nazie
: l’évocation de la guerre et des champs de cadavres. Himmler, qui aurait
d’abord préféré montrer le film sur le Tibet après une guerre gagnée,
hésita jusqu’en 1942 à autoriser sa diffusion publique. Mais ensuite il y
vit un moyen puissant d’accroître et de réchauffer l’enthousiasme guerrier
des Allemands. Des « directives pour la propagande »
accompagnèrent les représentations de l’œuvre d’art, qui reçut les trois
distinctions les plus élevées que l’Etat national-socialiste devait
décerner pour des films : « précieux pour la politique de l’Etat,
précieux artistiquement et précieux culturellement ». Les premières
eurent lieu dans les « différentes capitales de région [....] en
étroite relation avec les services SS ». Schäfer lui-même fut présent
à Berlin, Hambourg, Dresde, Halle, Weimar, Francfort sur le Main, Düsseldorf,
Cologne, Heidelberg, Strasbourg, Stuttgart, Augsbourg, Salzbourg, Linz,
Vienne, Klagenfurt, Innsbruck.
Dans plus de
400 organes de publication, le film fut commenté dans des articles qui
étaient presque tous rédigés avec l’accord préalable des services de
propagande et ensuite distribués aux organes de presse. La plupart des
titres des articles portaient un sous-titre énigmatique. Par exemple :
« Nous chevauchons dans la ville interdite du Dalaï-lama » ;
« Dans l’ombre du château des dieux » ; « Le secret du
Tibet dévoilé » ; « Avec la caméra dans le château des
dieux » ; « Laaloo – les dieux le
veulent » ; « Le château d’un roi-dieu » ;
« Le roi-dieu nous reçoit » ; « La brillante danse de
guerre des dieux » ; « Sous l’emprise des
démons » ; « Regard dans l’inconnu ». Au milieu de la
seconde guerre l’Allemagne tomba dans une « folie du Tibet ».
C’est seulement à la fin des années 90 que deux films sur le XIVe
Dalaï-lama (Kundun et Sept ans au Tibet)
éveillèrent un intérêt aussi grand.
Le film Le
secret du Tibet était plus qu’un documentaire culturel, il devait être
une épopée pour les « hommes complets » qui faisaient leur
service dans l’« Ordre Noir » de Himmler : « Par
l’esprit pionnier et le besoin
d’action de la jeune communauté SS, cette expédition a été préparée et
réalisée dans la réalité par une poignée d’hommes avec peu de dépenses et
seulement avec les moyens
nécessaires », écrivit la revue Der Freiheitskampf.
Schäfer et ses collègues chercheurs furent présentés comme des
« modèles » dont chaque SS et chaque Hitlerjugend
« normal » pouvait s’inspirer : aimant l’aventure, têtes brûlées,
cyniques, nécrophiles, fanatiques, racistes, arrogants, ambitieux à
l’extrême, disciplinés et serviles. Que ces qualités aient été associées à
des compétences scientifiques n’était pas une contradiction mais plutôt une
autre caractéristique de la typologie SS
pour les grades les plus élevés.
Le film
soulève la question de ce qui relève de la propagande nazie et des
présentations authentiques. Après tout, le spectateur perçoit ici des
images mouvementées, qui parlent et qui furent confirmées par de nombreux
rapports de voyageurs occidentaux au Tibet, même quand ceux-ci n’étaient
pas des nazis. Ainsi le film nazi sera-t-il souvent présenté sans esprit
critique comme un document précieux, anthropologique et historique. Par
exemple, dans une annonce de l’ORF au « Festival du
film bouddhiste » à Vienne en 2002 : « Dimanche soir
sera présentée une rareté cinématographique : ‘Le secret du Tibet’ est
un documentaire de l’UFA de l’année 1939 sur une expédition allemande au
Tibet ».
Quand
l’embarrassante « connexion Nazis-Tibet » fut proposée à la
discussion publique, on parla immédiatement dans ces milieux de
« projections nazies » sur la culture tibétaine. La plus aberrante
de ce genre de présentations vint d’un certain Tom Mustroph,
qui affirma dans un article sur le festival du film « BuddhaVision 2000 » que Himmler avait réinterprété
chrétiennement les rituels tibétains. Là, on peut lire : « Des
escouades de jésuites se mirent au travail et devinrent des spécialistes
d’horribles pratiques pour leurs propres intérêts jésuitiques, pour
réinterpréter des rituels tibétains comme étant d’origine chrétienne. Un
qui crut jusqu’à la fin dur comme fer à cette histoire, était d’ailleurs
Heinrich Himmler. En 1938, le premier des SS envoya une expédition en haute
montagne. Une équipe de tournage de l’UFA y participa. Le produit, le
documentaire de 90 minutes ‘Le secret du Tibet’, est l’une des
contributions les plus intéressantes du festival. » (BuddhaVision 2000)
Traduction: Franz Destrebecq
|