|
Gilles van Grasdorff
L’histoire secrète
des dalaï-lamas
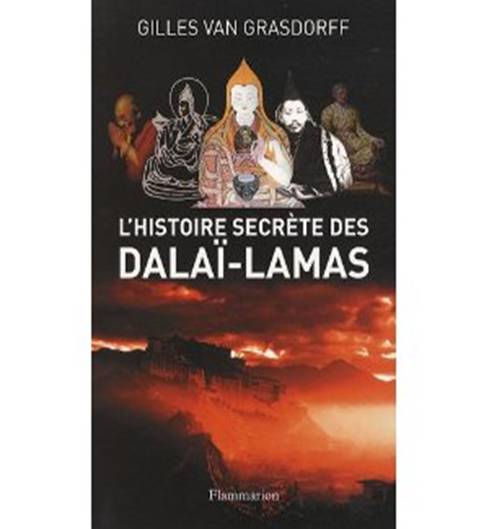
Flammarion 2009
Citations du Livre
Chapitre 3
«Étrange Tibet...
Au XIe siècle, des lamas, fervents adeptes du tantrisme, se sont
pourtant faits brigands et, déferlant sur les villes frontalières de la
Chine de la dynastie Song , attaquent les
caravanes de la route de la soie, pillent, violent et tuent. Mais ce n'est
pas tout. Ces lamas, fervents adeptes du Dharma, pratiquent des meurtres
rituels, à la suite desquels ils mangent certaines parties du corps de
leurs victimes en les mélangeant à de la tsampa.»
(p.59)
Chapitre 5
«...se montre de
plus en plus réticent aux études monastiques. Seuls les rites sexuels
du Tantra de Kalachakra retiennent son attention.
Commencées à l'âge de quatorze ans, ses premières initiations se sont faites
avec des fillettes de dix ans: jusqu'à leurs vingt ans, elles sont
considérées porteuses d'énergies positives. Victor et Victoria Trimondi expliquent dans Der schatten
des Dalai-Lama, L'Ombre du dalaï-lama, que
«dans le Vajrayana, la sexualité est l'événement
sur lequel tout est basé.» (p.79)
« Le sexe est
considéré ci; comme la prima materia, la
substance primale brute qui est utilisée par les partenaires sexuels pour
en extraire le pur esprit, de même que l'alcool fort peut être
extrait des grappes de raisin. Pour cette raison, le maître tantrique est
convaincu non seulement que la sexualité contient les secrets de
l'humanité, mais qu'elle fournit aussi le moyen par lequel on peut
atteindre la divinité. » Les Trimondi précisent
en outre que « plus le sexe est hot, plus le rituel tantrique devient
efficace. Dans le Candamaharosana Tantra par
exemple, l'amant avale avec une avidité joyeuse le liquide qui suinte du
vagin et de l'anus de l'amante et goûte sans nausée ses excréments, son
mucus nasal et les restes de nourriture qu'elle a vomis sur le plancher. Le
spectre complet des déviances sexuelles est présent, même si c'est sous la
forme de rite.»
«Par ces
initiations tantriques, la sexualité se transforme donc en puissance
temporelle et spirituelle. Des pratiques secrètes qui ont été délivrées au
sixième dalaï-lama et qui se perpétuent de nos jours aux degrés les plus
élevés de l'usage du Kalachakra dans les
monastères du bouddhisme tibétain. Ainsi, «une seule femme participe aux
étapes initiatiques 8 à 11 du Tantra du Kalachakra, mais dans les 12 à
15, dix femmes s'impliquent dans le rite aux côtés du maître. L'élève se
doit même d'offrir des femmes à songourou, et les
laïcs qui veulent être initiés d'amener leurs mères, sœurs, leur épouse,
filles ou tantes... Les moines ayant reçu la consécration ou les
novices ont le droit d'utiliser des femmes de diverses castes qui
ne sont pas parentes. Dans s le rite secret lui-même, les participants font
des expériences avec les semences masculines et féminines (sperme et
menstruation) ». (p.80)
«Nous sommes en
1702 et Rigdzin Tsangyang
Gyatso a tout juste dix-neuf ans. Son premier
amour l'a quitté mais, depuis, le dalaï-lama multiplie les aventures avec
les courtisanes et serveuses des tavernes.» (p.81)
«Le souverain
repère immédiatement le régent Sangyé Gyatso, devenu, au fil des semaines et des mois,
son compagnon de débauches nocturnes. Cette nuit encore sera longue et il
n'est pas rare alors de voir le dalaï-lama interpréter une de ses pièce de
théâtre ou de parodier les Trois Refuges que sont le Bouddha, le Dharma et la sangha, c'est-à-dire l'Enseignant, l'enseigné et la communauté, avec un
texte que l’on attribue à Drukpa Kunley :» (p.82)
«Je
prends refuge dans le pénis assagi du vieillard,
desséché à la racine,
renversé comme un arbre mort.
Je prends refuge dans le vagin flasque de la vieille femme, délabré,
impénétrable, comme une éponge.
Je prends refuge dans le Foudre viril du jeune tigre, fièrement dressé,
indifférent à la mort;
Je prends refuge dans le Lotus de la jeune fille,
la remplissant de vagues déferlantes de félicité,
et la délivrant de toute honte et inhibition ...» (p.83)
Chapitre 9
«Le Tantra du Kalachakra et, de façon plus générale, le bouddhisme tantrique
portent la femme aux nues et la placent en grande estime. Comme dans
beaucoup d'autres religions, elle est vénérée en tant que mère, en tant que
sœur, mais aussi en tant qu’épouse, maîtresse et objet de désir. Le tibétologue Rolf Stein écrit en 1982 : «Que ce soit
dans la religion ou dans le monde, c'est le sexe féminin qui est en tait
l'important... Mieux que cela, on dit que les lamas excellents qui
pratiquent la voie de l'union sexuelle doivent vénérer leur femme de
gnose (vidya, la compagne rituelle)
comme un instrument indispensable .
Dans le bouddhisme,
le vagin est en fait la porte de la réincarnation, l'accouplement une
cérémonie qui permet l’accession au secret de l'univers. La relation
sexuelle est fondamentalement ritualisée: chaque regard, chaque caresse,
chaque forme de contact reçoit un sens symbolique. Les partenaires
recherchent ensemble la voie vers quelque chose de supérieur à l'acte
lui-même. L'acte sexuel leur contére un pouvoir,
un savoir, que l'on n'obtient pas autrement.» (p.129)
«Un cas isolé ? Pas
exactement puisque, depuis, de nombreuses affaires ont défrayé la
chronique. Notamment l'une concernant la communauté américaine du bouddhisme
et l'un de ses maîtres les plus en vue, Osel Tenzin. Reconnu pour apprécier les pratiques du Traité
de Choephel, et pour son appétit sexuel, le lama
avait fini par contracter le Sida dans les années 1980.
À la même époque,
un lama réincarné surnommé la sagesse folle par ses pairs et ses disciples,
était connu pour son alcoolisme et ses excentricités sexuelles et
financières. Par ailleurs, un article de Jack Kornfeld
dans le Yoga Journal révèle, sous le titre de Sex
and Lives of the Gurus que, sur cinquante
maîtres bouddhistes, hindous et Jaïns, trente-quatre ont eu des rapports
sexuels avec leurs disciples.
Source : Gilles
Van Grasdorff, « L'histoire secrète des dalaï-lamas ».
Les esclaves
sexuelles des lamas
par Gilles Van Grasdorff
Reting Rinpoché, le
premier précepteur de l'actuel dalaï-lama, a eu le privilège suprême de
raser le crâne du petit garçon de Taktser dans le
temple du Jokhang à Lhassa et de lui attribuer
son nom religieux. Le 22 février 1940, Tenzin Gyatso est ainsi devenu officiellement le quatorzième
dalaï-lama.
Or Reting possédait la troisième structure économique
du Tibet, gérée depuis ses appartements de l'avant-dernier étage du palais.
En outre, d'aucuns lui attribuent des frasques nocturnes dans les bouges de
Shol et une relation officielle avec une dame de
Lhassa. Nous sommes alors dans les années 1940 et Reting
use et abuse du « Traité sur la Passion » de Guendun
Choephel (le Kama-sutra
tibétain). Or sa liaison fuite. « Le Kama-sutra
au Potala ! » dit-on, le scandale éclate. Et pour cause : la dame vit
quasiment à demeure dans les appartements du régent. On s'en amuse beaucoup
puisque à Lhassa des affiches, placardées tous les soirs sur les arbres,
près du Jokhang et des autres temples de la
capitale, se mirent à conter les galipettes de la dame et de son amant.
Sept ans plus tard, le 17 avril 1947, Reting fut
arrêté, jugé et emprisonné dans les geôles du Potala. Il mourra trois
semaines plus tard, le 8 mai, dans sa cellule, ses organes génitaux broyés.
Un cas isolé ? Pas exactement puisque, depuis, de nombreuses affaires ont
défrayé la chronique. Notamment l'une concernant la communauté américaine
du bouddhisme et l'un de ses maîtres les plus en vue, Osel
Tenzin. Reconnu pour apprécier les pratiques du
Traité de Choephel, et pour son appétit sexuel,
le lama avait fini par contracter le Sida dans les années 1980.
À la même époque, un lama réincarné surnommé « la sagesse folle » par ses
pairs et ses disciples, était connu pour son alcoolisme et ses
excentricités sexuelles et financières. Par ailleurs, un article de Jack Kornfeld dans le « Yoga Journal » révèle, sous le titre
de « Sex and Lives of
the Gurus » que, sur cinquante maîtres bouddhistes, hindous et Jaïns,
trente-quatre ont eu des rapports sexuels avec leurs disciples.
En 1994, un autre lama se voit accusé, lui, d'avoir, sur une période de plusieurs
années, abusé de son statut de réincarnation et de guide spirituel pour
imposer des relations sexuelles à des jeunes femmes disciples. De médiation
en médiation, le guru tibétain aurait versé plusieurs millions de dollars à
ses victimes...
Le 10 février 1999, le journal américain The lndependent
annonce un autre scandale sexuel sous la plume de Paul Vallely
: la philosophe écossaise June Campbell.
traductrice officielle des lamas tibétains, affirme en effet avoir été «
l'esclave sexuelle tantrique » de Kalou Rinpoché, un des lamas tibétains les plus vénérés au
monde. On s'en doute, l'affaire fait grand bruit : « C'était, dit-elle,
comme si j'avais accusé Sœur Teresa d'avoir joué dans des films porno. »
Menacée de mort, l'Écossaise a attendu onze ans avant de parler de cette
histoire. Ses accusations furent vivement démenties par les proches de
celui qu'elle dénonce.
Une autre fois, c'est à Samye Ling Centre, en
Écosse, que le scandale éclate. Dans un article du Sunday
du 10 septembre 2000, Robert Mendick raconte
qu'un moine adulte de Samye Ling a abusé d'une
jeune fille de quatorze ans. Or Samye Ling est un
lieu considéré comme le poumon de la culture tibétaine en Occident, où l'on
accueille les artistes amis du dalaï-lama, tels Richard Gere ou David
Bowie.
Le 10
juin 2009, j'ai demandé au dalaï-lama de bien vouloir répondre à quelques
questions, notamment sur le fait que, depuis un certain temps, des articles
de presse et des livres évoquent les dérapages de lamas de renom, accusés
d'agressions sexuelles et de viols ou encore d'avoir des « esclaves
sexuelles tantriques ». Une vingtaine de jours plus tard, le 4 juillet, Sa
Sainteté le quatorzième dalaï-lama Tenzin Gyatso répondra, par l'intermédiaire de son secrétaire Chhime R. Chhoekyapa :
« Cher Monsieur Gilles Van Grasdorff,
Veuillez
excuser notre retard à répondre à votre courrier électronique du 10 juin
2009, dans lequel vous demandiez des éclaircissements de la par de Sa
Sainteté concernant le bouddhisme à certaines des questions soulevées dans
votre lettre. Sa Sainteté a été très occupée ces dernières semaines, qui
ont inclus de grands voyages. Nous n'avons donc pas été en mesure de
répondre plus tôt. Nous espérons que vous comprendrez.
Dans le même temps, nous voudrions qu'il soit bien clair pour vous dès le
départ que tout comportement non conventionnel n'est pas en accord avec les
enseignements de Sa Sainteté et la pratique. Dans le bouddhisme tibétain
aussi il y a des personnes qui s'égarent et si elles ne respectent pas
leurs vœux, des mesures appropriées sont prises. Dans la mesure où nous en
sommes conscients, ceux qui ne peuvent pas garder leurs vœux monastiques,
etc. ... quittent le monastère... »
Ces histoires de sexe dans les lamasseries et les
monastères occidentaux peuvent choquer nos esprits occidentaux redevenus
pudibonds mais il est important de souligner que les lamas tibétains n'ont
jamais cessé d'utiliser des « esclaves sexuelles » dans les rites
tantriques, dont le Kalachakra. Et ce au nom
d'une tradition de pratiques secrètes qui remonte au VIIIe siècle, et à ce
temps lointain où Padmasambha introduisait le
bouddhisme au Tibet. Le fondateur de l'école Nyingma
avait lui-même cinq « esclaves sexuelles tantriques » parmi ses disciples.
Dès lors, on peut dire qu'en 2009, rien n'a vraiment changé au pays des
lamas tibétains et que certains — des brebis galeuses — s'égarent. Si ce
n'est que des femmes comme June Campbell et des
chercheurs comme Victor et Victoria Trimondi
osent briser la loi du silence imposée par les propagateurs du Tantra du Kalachakra.
Source : https://bouddhanar.blogspot.co.at/2016/02/les-esclaves-sexuelles-des-lamas.html
Histoire secrète des
dalaï-lamas (Flammarion, 2009) de Gilles van Grasdorff :
un livre qui souffle le chaud et le froid
par Albert Ettinger
le 19 mai 2016
Voici un livre, pourtant sorti de la
plume d’un auteur proche du dalaï-lama et des exilés tibétains, qui
« risque de mettre un coup à ceux qui ont une image idyllique »
de l’ancien Tibet, comme le remarque fort à propos un lecteur sur le site
d’une grande librairie en ligne.
En effet, van Grasdorff
trace un portrait sans complaisance de la société tibétaine telle qu’elle a
existé jusqu’à la fin des années 1950. Il évoque (p. 55 et suivantes) les
« clans familiaux » aristocratiques qui possédaient des domaines
où ils avaient « droit de vie et de mort sur les populations »
qui y habitaient. Il parle de la grande majorité des Tibétains qui étaient
des serfs, dont les mieux lotis avaient « une identité légale, un lien
de dépendance héréditaire à un domaine ou un monastère : c’est le
servage du Moyen Âge », tandis que les autres vivaient comme des
« ouvriers itinérants » ou louaient une parcelle de terre au
propriétaire terrien dont ils dépendaient. Il confirme l’existence
d’esclaves (appelés nangzan) et note que, leur
commerce « étant fort lucratif au Tibet des dalaï-lamas, il a perduré
jusqu’en 1950 ». (p. 416) Il confirme aussi l’existence de castes de
parias vivant en marge de la société.
Quant à l’aspect misérable des
principales agglomérations tibétaines, il cite cette description de Shigatse, deuxième ville du Tibet et capitale du Tsang,
donnée par l’explorateur suédois Sven Hedin :
« Rien que des ruelles étroites, sordides de bourbiers, de cadavres de
chiens et de détritus, avec çà et là quelques placettes non moins sales.
Dans un contraste frappant avec cet amas de bicoques, sur un mamelon isolé
se dresse un entassement de constructions grandioses. Une vision de
puissant château protégeant un village de manants. »
Ces châteaux-forts ne servaient
pourtant guère à la protection des « manants », mais plutôt à
leur oppression, et aussi à des objectifs militaires lors des incessantes
guerres civiles entre les différentes sectes et les seigneurs féodaux qui
les soutenaient.
À la différence de beaucoup d’autres,
l’auteur ne passe pas non plus sous silence la justice moyenâgeuse qui
existait au pays des dalaï-lamas : Même sous le 13e et ses
successeurs, écrit-il, « il y a des geôles dans les sous-sols du
Potala – de même qu’il y en a à Tashilhunpo et
dans chacun des monastères du bouddhisme tibétain – et la peine de mort
s’applique à tous les échelons de la société, depuis les tulkus jusqu’aux serfs et esclaves. L’énucléation,
l’arrachage des tendons, l’écartèlement, l’écrasement des testicules sont
parmi les peines les plus courantes, avec l’empoisonnement. » (p. 196)
À ne pas oublier « les bastonnades et les tortures », utilisées
déjà lors des interrogatoires aussi bien sur les accusés que sur les
plaignants, ainsi que l’« amputation du pied ou de la main ». (p.
60-61)
Puis, emboîtant le pas à Victor et
Victoria Trimondi (Der Schatten
des Dalai Lama/The Shadow
of the Dalai-Lama),van
Grasdorff s’intéresse à cette face cachée du
bouddhisme tibétain que sont les rites et initiations tantriques ainsi que
les pratiques sexuelles secrètes des lamas. Au sujet des premiers, après
moult détails répugnants et immondes à souhait, il en tire la conclusion
que le « spectre complet des déviances sexuelles est présent, même si
c’est sous la forme de rite. » (p. 80) Quant à la vie sexuelle cachée
des lamas, il relate les « excentricités sexuelles et
financières » de quelques-uns, dont le régent et premier précepteur de
l’actuel dalaï-lama. Il nous apprend que déjà le très vénéré Padmasambhava,
qui a introduit le bouddhisme tantrique au Tibet, « avait lui-même
cinq ‘esclaves sexuelles tantriques’ parmi ses disciples » ; et
il finit par citer un article de Jack Kornfeld
dans le Yoga Journal qui, « sous le titre de Sex and Lives of
the Gurus » révéla que, « sur cinquante maitres bouddhistes,
hindous et Jains, trente-quatre ont eu des rapports sexuels avec leurs
disciples. » (p. 133)
Sur sa lancée, van Grasdorff
va jusqu’à confirmer la pratique des « sacrifices humains » et du
cannibalisme dans l’ancien Tibet : « Au XVIIe siècle, le
cinquième dalaï-lama va tenter de mettre fin à ces sacrifices et aux
rituels tantriques des lamas cannibales. Mais c’est en vain… » (p. 58
suivantes et p. 416) Nos tibétologues
occidentaux, souvent adeptes du « dharma » eux-mêmes, ont
pourtant l’habitude de dénoncer de telles affirmations comme de la
propagande mensongère des communistes chinois.
Plus étonnant encore est le fait que
cet admirateur du 14e dalaï-lama ose poser des questions sur les
agissements de « Sa Sainteté » en personne, quand il (se)
demande (p. 19) : « … que dire des relations pour le moins
ambiguës dans les années 1980, de Tenzin Gyatso avec Shoko Asahara, le
gourou de la secte Aum, qui annonçait
l’apocalypse (…) et qui se disait disciple du dalaï-lama ? ʺUn
ami, peut-être pas parfait, mais un ami ʺ furent
les mots du souverain tibétain après l’attentat au gaz sarin de Tokyo le 20
mars 1995. » Encore après l’attentat ! Voilà un ami vraiment
fidèle ! Comme Harrer, dont le mot d’ordre
en tant que membre des SS fut « Unsere Ehre heißt Treue ! » (Notre honneur, c’est la
fidélité !) Malheureusement, van Grasdorff
ne s’attarde pas plus sur la question.
Ceci dit, tout lecteur sérieux et tant
soit peu rationnel ne peut qu’être agacé par la crédulité et le manque
d’esprit critique qui continuent de marquer van Grasdorff
dès qu’il s’agit de croyances et de « spiritualité » tibétaine.
En effet la fascination pour le mysticisme que l’auteur éprouve suinte de
partout. Il s’attarde ainsi sur les « visions » et « signes
miraculeux » qui, selon la version officielle lamaïste, auraient
conduit à la découverte non moins miraculeuse de l’actuel dalaï-lama. Il se
montre un parfait comique involontaire en décrivant la
« purification » du mercure si cher à la médecine lamaïste (on
doit le faire bouillir dans de l’urine). Il donne l’impression de croire
aux prophéties et aux oracles ainsi qu’à la possibilité des lamas à gérer
eux-mêmes leur « fin de vie » en projetant leur « conscience
hors du chakra coronal ». Le lecteur sceptique appréciera tout
spécialement l’explication suivante qu’il y ajoute : « Pour le
dalaï-lama et les autres bodhisattvas, ce transfert s’effectue toujours par
le sommet du crâne, mais pour les autres hommes, il peut se faire par les
orifices inférieurs : ils risquent alors de renaître dans un autre
monde que celui des humains… » (p. 64)
Enfin, le côté « journaliste à
sensation » de van Grasdorff apparaît dès qu’il
aurait fallu vérifier ce que disent des sources pourtant sujettes à
caution. C’est ce qu’auraient fait un historien et un journaliste sérieux.
Ce manque s’avère particulièrement évident quand, au sujet du Tibet chinois
moderne, van Grasdorff reprend tous les mensonges
grossiers de Dharamsala. Au lieu de faire preuve
d’un minimum d’esprit critique, il se laisse alors entraîner par ses
sympathies de toujours et son militantisme dalaïste.
Par conséquent, son soutien aux séparatistes tibétains est sans faille,
comme l’est son hostilité envers la Chine et envers tout ce qui est
« communiste ». Dès qu’il parle de la situation au Tibet après
l’arrivée de ceux qu’il appelle « les hordes communistes » (p.
259), on a donc l’impression de lire un pamphlet en provenance de Dharamsala où de Washington. Van Grasdorff
fait même sienne la folle revendication d’un Grand Tibet en évoquant, par
exemple, une prétendue occupation chinoise de « l’Amdo »
et du « Kham » tibétains en 1950, ou en
situant le Lop Nor dans
« l’Est tibétain » et en voyant dans la région du Kokonor « le Tibet » transformé en
« décharge nucléaire ».
Source : http://www.tibetdoc.eu/spip/spip.php?article329
Shambhala, convergence du nazisme et du bouddhisme tibétain – Gilles Van Grasdorff
|